 Le centre de gravité occidental a vécu …Réflexions de Bertrand Badie.
Le centre de gravité occidental a vécu …Réflexions de Bertrand Badie.
Q. : L’année 2023 est-elle l’année la plus calamiteuse depuis 1945 ?
B. Badie : Difficile à dire. Mais il est évident qu’elle restera dans les mémoires. Pas seulement à cause de ces guerres proches et sinistres (Israël-Hamas, Russie-Ukraine), mais parce qu’elle aura été le révélateur de transformations de fond que nous avons été incapables d’identifier, ou que nous avons ignorées, et qui s’affichent désormais à l’œil nu. En réalité, nous restons convaincus de vivre encore dans le monde fondé en 1945 sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une illusion complète.
Q. : Pour quelles raisons ?
BB : Nous feignons de croire que les rapports classiques entre les principales puissances ont le pouvoir de tout régler. Nous imaginons vivre dans un monde unifié au sein duquel tous les acteurs donneraient la même signification à tout. Or, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette vision du monde était déjà caduque, mais nous n’y avons pas pris garde. On pressentait alors l’avènement d’un nouvel ordre dont le centre de gravité multiséculaire, l’Occident, allait céder du terrain au profit d’autres formes de pouvoir. Malheureusement, les dirigeants, occidentaux en particulier, sont restés bloqués sur la compétition entre puissances, sous l’emprise de la notion périmée de souveraineté. Ils refusent de comprendre que la mondialisation a consacré l’interdépendance et la mobilité, et s’acharnent par exemple à dénoncer la migration, à la considérer comme transgressive. L’ensemble Europe-Amérique du Nord ne s’est pas vraiment remis en question, alors que tout a changé. Il se comporte comme s’il était resté le seul centre actif du monde.
Q. : Qui gagne la guerre en Ukraine, au-delà du blocage total sur la ligne de front, qui ne bouge plus vraiment depuis des mois ?
B.B. : Force est de constater que le plus fort n’a pas vaincu, ce qui confirme un paradigme qui date du début de la guerre froide. Rappelons que la Russie devait prendre Kiev en trois jours, que personne ne pariait un centime sur la survie politique et même physique du président Zelensky, auquel les Américains conseillaient d’ailleurs de prendre la fuite ! Or, à la place, nous avons assisté à la résistance totalement inattendue de tout un peuple. Ce qui démontre que ce n’est pas le rapport de force arithmétique qui prévaut, mais bien plutôt la capacité de l’énergie sociale, que l’on a toujours négligée dans les relations internationales. Je note aussi la péremption de la notion de conquête territoriale. Poutine voulait la remettre au goût du jour avec une guerre à l’ancienne qui a échoué.
S.E. : La superpuissance américaine ne peut ou ne veut plus intervenir. Il n’y a plus de gendarme sur la planète, si bien que la peur du gendarme a cessé d’être elle aussi…
B.B. : Ce n’est pas tant le gendarme qui a disparu que sa capacité à exercer son rôle. Depuis que le système international existe, disons, en gros, depuis la Renaissance européenne, tout reposait sur l’idée que le plus fort pouvait établir ou rétablir un ordre. Les choses se sont passés ainsi jusqu’en 1945, la Seconde Guerre mondiale marquant l’apogée de cette logique : la coalition de vainqueurs avait terrassé le monstre nazi. La force était donc non seulement efficace, mais elle était aussi nimbée de vertu puisqu’elle avait terrassé le Mal. Depuis lors, l’idée que la puissance s’imposera sans coup férir ne fonctionne plus : quand un puissant veut régler une affaire du monde, il est tenu en échec, voire carrément vaincu. C’est le chemin de croix des Etats-Unis : Vietnam, Somalie, Irak, Afghanistan, pour ne citer que les principaux. Mais ils n’ont pas le monopole de l’échec de la puissance. Je pense à l’URSS en Afghanistan, au tournant des années 1970-1980, ou encore à la France dans les guerres de décolonisation et aujourd’hui au Sahel.
Q. : Comment les Européens, qui n’ont toujours pas de force militaire commune, parviendraient-ils à surmonter les menaces présentes et à venir sans le parapluie américain ?
B.B. : Ils ne savent pas penser le présent sans la référence permanente au passé. Dans ce sens, les Etats-Unis gardent en effet ce rôle de pompier de dernière instance qu’ils exercent depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Or cette notion est dépassée, mais n’exagérons pas non plus l’isolationnisme américain. Il existe certes un désir profond au sein de la société américaine de rompre avec le messianisme fondateur des pèlerins du Mayflower, d’abandonner le rôle de tuteur protecteur. Le slogan ‘America First’ de Trump résume cette tendance. En même temps, je ne suis pas certain que les dirigeants américains aient totalement renoncé à la destinée mythique de leadership sur le monde. Le débat n’est d’ailleurs pas achevé sur la scène politique américaine, entre les tenants d’un néo-isolationnisme trumpien et ceux d’un messianisme à portée limitée, comme Barack Obama, auteur de ces deux formules, le lightfoot et le leadership from behind.
Q. : A quelle tendance appartient selon vous le président actuel, Joe Biden, qui sera très probablement candidat à sa succession l’an prochain malgré les doutes sur son âge avancé ?
B.B. : Il reste encore, peut-être pour des raisons générationnelles, très marqué par la vieille idée de leadership américain que l’on retrouve à travers sa rhétorique sur l’Ukraine, mais aussi dans ce geste réflexe, qui lui a coûté au demeurant très cher, d’effectuer une tournée au Proche-Orient aussitôt après le 7 octobre (date de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël). Personne ne l’a vraiment entendu ni écouté, une vraie humiliation, comme pour lui démontrer que c’est une vision datée que de croire que les Etats-Unis avaient encore le pouvoir de tout régler. 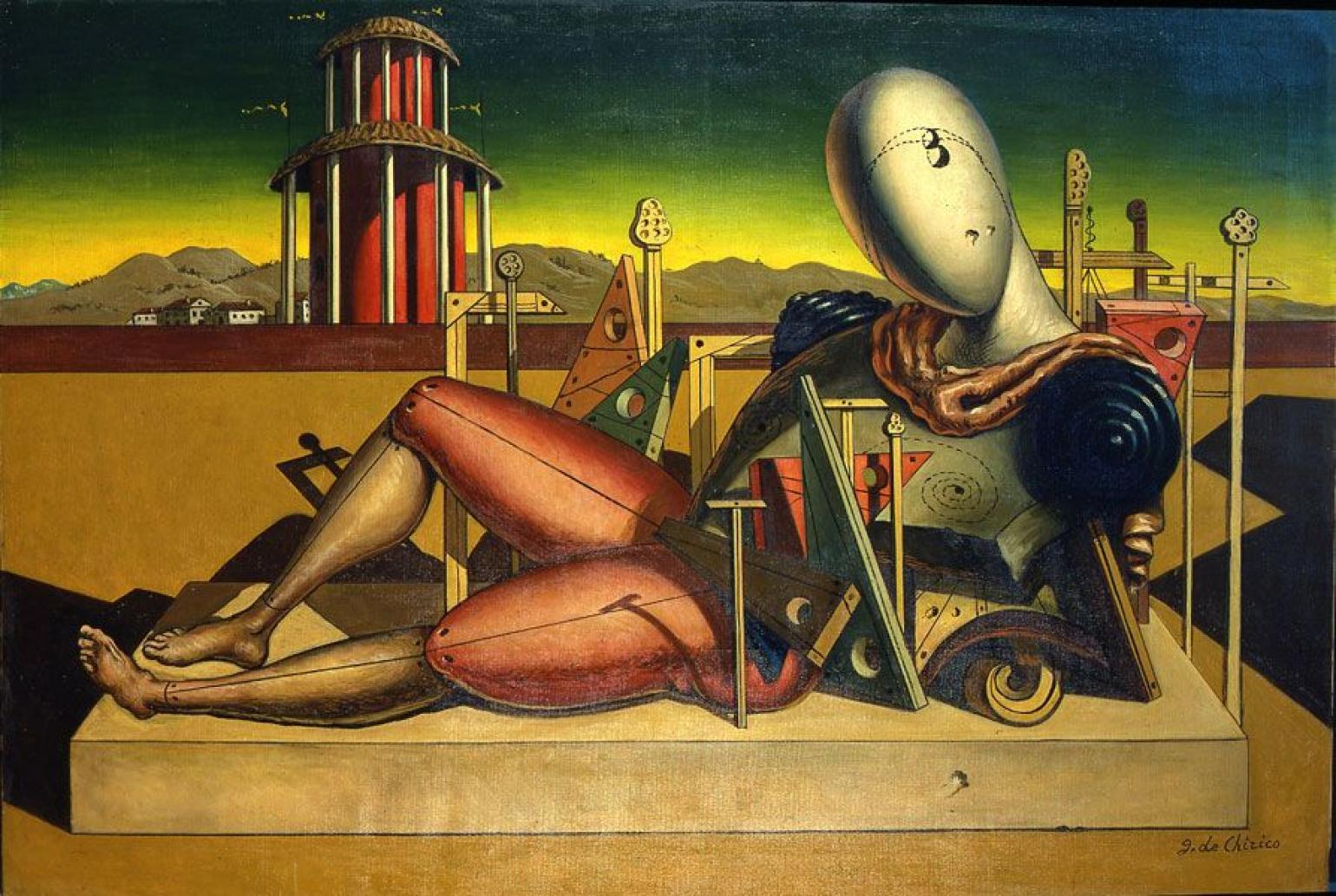 Q. : A quoi sert encore l’ONU ? En Ukraine comme à Gaza, elle semble totalement impuissante.
Q. : A quoi sert encore l’ONU ? En Ukraine comme à Gaza, elle semble totalement impuissante.
B.B. : Le système onusien a été créé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en partant du principe qu’une connivence entre puissants (les 5 permanents du Conseil de sécurité ou P5 ) suffisait à maintenir la paix, ce qui ne fonctionne plus. D’abord parce que l’essentiel des guerres contemporaines n’est plus un choc entre Super-grands, mais vient de la décomposition de pays du Sud qui n’en finit pas. Et parce que les ferments de guerre aujourd’hui sont davantage sociaux que politiques. Par conséquent, travailler à la paix, c’est travailler à ce que les experts nomment aujourd’hui la ‘sécurité globale’, celle de la planète comme un tout et non celle de ses composantes étatiques. A ce titre, il est d’ailleurs incroyable de constater que le Conseil de sécurité (de l’ONU) refuse de s’emparer des grandes questions climatiques, alimentaires ou sanitaires, considérant qu’elles sont extérieures à la sécurité, ce qui montre à quel point il est en décalage avec son temps. Il est indispensable de recentrer les Nations Unies sur les grandes questions sociales mondiales. Un grand secrétaire général de l’ONU comme Kofi Annan, en son temps, avait saisi cette dimension. Mais aujourd’hui, c’est la paralysie qui domine.
- Q. : En quoi consiste concrètement cette ‘sécurité globale’ que vous venez d’évoquer ?
B.B. : L’insécurité humaine ne cesse d’augmenter. La faim dans le monde fait 10 millions de morts par an, l’équivalent de huit attaques sur le World Trade Center de New York chaque jour. L’insécurité sanitaire, on en sait quelque chose depuis la pandémie de Covid-19. L’insécurité climatique, je n’ai pas besoin de dresser le tableau, elle est partout. Un exemple ? La désertification progresse de 10 centimètres par heure au Sahel. Et tous ces facteurs tuent une seconde fois en devenant le vrai déclencheur des nouvelles guerres. On ne peut pas concevoir les conflits en Afrique (Sahel, Congo, Corne de l’Afrique) et tant d’autres ailleurs sans avoir en tête ces paramètres.
- Q. : Qui sont les gagnants et les perdants de ce nouveau désordre mondial ?
- B.B. : Les perdants sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui, jouant les autruches, ne veulent pas voir la réalité, au premier rang desquels figurent les puissances occidentales. Les gagnants sont encore difficiles à identifier, mais j’en vois au moins trois. Le premier est un Sud qui a très longtemps inscrit son non-alignement sur un mode négatif, c’est-à-dire avec l’obsession de ne pas dépendre de, ou froisser, l’Amérique ou l’URSS. Aujourd’hui, les diplomaties du Sud sont de plus en plus convergentes et organisées, pour devenir des acteurs efficaces du nouveau jeu international, indépendamment des parrainages d’autrefois. Le deuxième gagnant est la Chine, qui est de facto le leader de ce Sud recomposé. La Chine est la seule des grandes puissances classiques à voir son influence sur le monde croître. On le voit au Moyen-Orient, où ni l’Europe, ni les Etats-Unis, ni la Russie ne parviennent à calmer le jeu, alors que Pékin est en train de réconcilier l’Iran et l’Arabie saoudite.
- Q. : Et quel est le troisième larron ?
- B.B. : C’est bien entendu la Russie, qui mène un jeu extraordinairement dangereux. Poutine, qui s’est révélé piètre stratège militaire, manœuvre toutefois subtilement en transformant ses défaites militaires en victoires diplomatiques. Alors qu’il a été défait devant Kiev, il se tourne vers le Sud en affectant le statut de victime de l’hégémonie occidentale, proposant en quelque sorte de conduire un front anti-occidental, ce qu’il fait au sein des BRICS (bloc regroupant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, qui seront rejoints dès janvier 2024 par l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Ethiopie et l’Iran, où sa présence est pourtant anachronique puisque la Russie n’est pas un pays du Sud.
Q. : On parlait autrefois de ‘tiers-monde’. Puis, de ‘pays en développement’. On a ensuite dit pays émergents, avant que s’impose le bloc des BRICS. Et puis, désormais, on parle de Sud global (Global South). Que recouvre ce glissement du vocabulaire géopolitique ? B.B. ; C’est justement là que s’opère le changement le plus important sur la scène globale. Ces liens qui se construisent ne sont plus institutionnels sur le mode des alliances militaires du temps de la guerre froide. Il n’y a plus, en face de l’OTAN, d’alliance militaire unifiée qui soit en voie de constitution. On trouve au contraire quantité de structures d’intégration, d’ententes de circonstance. ‘L’union libre’, si j’ose l’expression, est la nouvelle tendance de l’efficacité internationale. Et les Etats du Sud savent jouer de cette mobilité sans s’encombrer de l’ancienne logique des blocs qui agit sur eux comme un repoussoir. L’année 2023 aura montré plus que jamais à quel point l’OTAN demeure le dernier grand bloc militaire défensif. Ce qui est vu par le reste de la planète comme un summum d’entre-soi et d’arrogance, un club dont les membres auraient à décider du sort du globe parce qu’ils se considèrent plus intelligents et plus vertueux que les autres.
B.B. ; C’est justement là que s’opère le changement le plus important sur la scène globale. Ces liens qui se construisent ne sont plus institutionnels sur le mode des alliances militaires du temps de la guerre froide. Il n’y a plus, en face de l’OTAN, d’alliance militaire unifiée qui soit en voie de constitution. On trouve au contraire quantité de structures d’intégration, d’ententes de circonstance. ‘L’union libre’, si j’ose l’expression, est la nouvelle tendance de l’efficacité internationale. Et les Etats du Sud savent jouer de cette mobilité sans s’encombrer de l’ancienne logique des blocs qui agit sur eux comme un repoussoir. L’année 2023 aura montré plus que jamais à quel point l’OTAN demeure le dernier grand bloc militaire défensif. Ce qui est vu par le reste de la planète comme un summum d’entre-soi et d’arrogance, un club dont les membres auraient à décider du sort du globe parce qu’ils se considèrent plus intelligents et plus vertueux que les autres.
Q. : Au fond, est-ce que ce ne sont pas les valeurs occidentales (démocratie, droits de l’homme) qui sont refusées ?
B.B. La démocratie et l’Etat de droit sont certes les valeurs communes de l’Occident, mais pas depuis très longtemps, si l’on aborde les choses avec un minimum de profondeur historique. Du temps de mes parents, les valeurs européennes étaient portées par l’Allemagne nazie et la Russie stalinienne, donc arrêtons de grâce cette géopolitique des valeurs ! Et puis, je ne crois pas sociologiquement à l’effectivité des valeurs collectives. Dans une société donnée, en France ou en Suisse, il n’y a pas homogénéité de valeurs, elles sont interprétées de manière très différente par différents segments de la population. Quand on présente Israël comme la pointe avancée de l’Occident démocratique et vertueux au Moyen-Orient, on voit bien que l’axiome ne tient pas. La colonisation en Cisjordanie, la négation du peuple palestinien et de ses droits, le carnage à Gaza sont autant d’éléments qui nous mettent, nous les Occidentaux, sur un plan d’égalité avec tous les autres peuples. Il n’y a pas de peuple plus vertueux que d’autres ; il n’y a pas d’histoire plus noble que d’autres. Il y a, dans chaque histoire, un combat incessant entre une idée d’humanité et la volonté destructrice de déshumaniser. Les relations internationales sont, au fond, la science des souffrances humaines.
ITW de Bertrand Badie par Serge Enderlin,
publiée dans l’hebdomadaire l'Illustré, édité à Lausanne.
le 2 janvier 2024
avec l’aimable autorisation de l’auteur.
